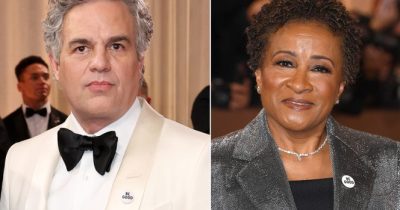Quelques heures à peine après la formation du gouvernement Lecornu II, une phrase du nouveau ministre du Travail et des Solidarités, Jean‑Pierre Farandou, a enflé les débats. Lors de son premier passage sur le plateau du JT de 20 h sur France 2, il a affirmé : « On n’est pas sourds, on n’est pas autistes, on voit bien qu’elle passe mal cette réforme ».
Ces propos, perçus comme stigmatisants envers les personnes autistes, ont provoqué une vaste réaction politique, associative et médiatique. Le ministre a finalement présenté ses excuses, mais l’incident soulève de nombreuses questions sur le langage public, le handicap et la responsabilité des responsables politiques.
Dans cet article, nous revenons sur les faits, les réactions, les enjeux du débat sur le handicap dans le discours politique, et les conséquences possibles pour le ministre et le gouvernement.
Le contexte et les propos polémiqueux
Le nouveau gouvernement et la réforme des retraites
Jean‑Pierre Farandou, récemment nommé ministre du Travail et des Solidarités, intervient peu après l’annonce du Premier ministre Sébastien Lecornu d’une suspension (ou d’un ajustement) de la réforme des retraites. Sur le plateau du JT de France 2, interrogé par Léa Salamé sur cette réforme, il a voulu défendre la décision gouvernementale en affirmant :
« On n’est pas sourds, on n’est pas autistes, on voit bien qu’elle passe mal cette réforme. »
L’usage de « sourds » et « autistes » comme métaphores pour signifier « ne pas comprendre » ou « ne pas entendre » a été immédiatement contesté. Plusieurs médias ont souligné que la phrase, diffusée en direct, était particulièrement maladroite.
La polémique s’enflamme
La formulation de M. Farandou a suscité une vive vague de réactions, tant du côté des associations que des élus politiques :
- La députée écologiste Marie‑Charlotte Garin a déclaré : « Être autiste n’est pas une incapacité à comprendre les choses. C’est une particularité neurodéveloppementale, pas un défaut d’intelligence ou d’empathie. »
- La députée Anaïs Belouassa Cherifi (LFI) a dénoncé des propos « indignes et inacceptables », qu’elle juge comme « du mépris validiste répugnant ».
- Le Collectif Handicaps, regroupant 54 associations nationales, a demandé que le ministre « évite d’utiliser le terme ‘autiste’ à tort et à travers » dans ses discours publics
La presse parle d’un « dérapage validiste », c’est-à-dire d’un propos qui reflète une forme de discrimination ou de mépris implicite envers les personnes en situation de handicap.
Les excuses et leurs limites
La réaction du ministre
Face à l’ampleur de la controverse, Jean‑Pierre Farandou a publié en soirée une déclaration d’excuses sur le réseau social X (ancien Twitter) :
« En utilisant le terme d’autiste, mes propos ont blessé et ce n’était pas mon intention. J’en suis sincèrement désolé et je présente mes excuses. »
Certains médias soulignent cependant que l’« excuse » est intervenue tardivement, après une montée des critiques.
Analyse critique des excuses
Les réactions restent mitigées. Plusieurs observateurs estiment que si les excuses étaient nécessaires, elles ne suffisent pas à éteindre le débat sur le langage employé par une autorité publique. L’incident révèle une attente accrue de responsabilité dans le choix des mots des personnalités politiques, notamment lorsqu’il s’agit de sujets liés au handicap.
Le handicap et le langage politique : enjeux et réflexions
Le validisme dans le discours public
Le terme validisme désigne les attitudes, représentations, pratiques ou structures qui valorisent les personnes dites « valides » au détriment de celles en situation de handicap. Dans le cas présent, l’usage métaphorique de « autiste » pour signifier « qui ne comprend pas » véhicule des stéréotypes négatifs : l’autisme, dans le débat public, est parfois réduit à une forme de fermeture, d’isolement ou d’incompréhension. Plusieurs associations et acteurs de la santé mentale rappellent qu’il s’agit d’une « particularité neurodéveloppementale », non d’une déficience intellectuelle ni d’un choix de comportement.
Le débat dépasse la simple maladresse linguistique : quand un ministre des Solidarités fait une telle déclaration, cela peut être perçu comme un message implicite de légitimation de stigmatisations.
Le rôle des responsables publics
Le vocabulaire utilisé par les responsables publics revêt une importance particulière, puisqu’il influe sur les représentations collectives. Les élus, ministres et médias sont souvent invités à adopter un discours inclusif et respectueux, surtout sur les sujets sensibles comme le handicap, les questions de genre, l’ethnicité, etc. Une gouvernance consciente de ces enjeux doit tenir compte de la portée symbolique des mots.
En France, plusieurs démarches existent pour sensibiliser aux « bonnes pratiques langagières » concernant le handicap, notamment dans les chartes de communication des institutions publiques ou des médias spécialisés.
Conséquences politiques et perspectives
Pour le ministre et le gouvernement
Cette première polémique ne met pas directement en péril le gouvernement Lecornu II, mais elle fragilise la crédibilité de son ministre du Travail et des Solidarités – un poste central dans la mise en œuvre des politiques sociales. Le ministre devra désormais faire preuve d’une vigilance accrue dans ses allocutions, d’autant que le débat sur les retraites promet d’être socialement conflictuel.
Le risque de surenchère médiatique
Dans le climat actuel de forte polarisation, toute maladresse peut devenir un élément de polémique prolongée. Le gouvernement doit veiller à ne pas alimenter une spirale négative où chaque mot serait scruté et potentiellement détourné.
Vers un débat plus large
L’incident pourrait ouvrir une réflexion plus générale sur l’usage des métaphores liées au handicap dans la langue courante — non seulement au niveau politique, mais aussi dans les médias, l’éducation et la vie quotidienne. Il offre une opportunité pour les associations, les formateurs, et les institutions de proposer des guides, des chartes ou des campagnes de sensibilisation autour du langage non stigmatisant.
La déclaration « On n’est pas autistes » du ministre Jean‑Pierre Farandou aura coûté cher, non seulement en critiques immédiates, mais aussi en image institutionnelle. Cet épisode rappelle que le langage public n’est jamais neutre : les mots choisis par un responsable politique peuvent blesser, stigmatiser ou exclure implicitement.
Si les excuses du ministre étaient indispensables, elles ne suffisent pas à clore un débat plus profond sur la relation entre le handicap et les représentations collectives. Pour le gouvernement, c’est une leçon sur l’importance de la précision, de l’empathie et de la responsabilité dans l’exercice du pouvoir.
Si tu veux, je peux te proposer une version enrichie avec des témoignages d’associations, des analyses juridiques, ou une version adaptée pour un public non-spécialiste. Veux‑tu ça ?
LIRE AUSSI : L’État condamné à indemniser un détenu pour une console de jeu endommagée lors d’un transfert
LIRE AUSSI : Gel des APL en 2026 : suppression pour certains étudiants étrangers dans le projet de budget