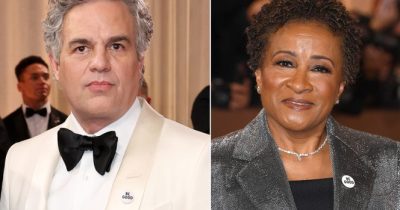Un jugement rendu en septembre 2025 par le tribunal administratif d’Orléans a soulevé l’intérêt médiatique : un détenu du centre pénitentiaire d’Orléans‑Saran a obtenu réparation après que sa console de jeux (et la manette associée) aient été endommagées ou perdues durant un transfert.
Cette décision, symbolique bien que modeste sur le plan financier, rappelle le principe selon lequel l’administration pénitentiaire reste responsable des biens confiés à sa garde. Dans cet article, nous revenons sur les faits, le fondement juridique de la décision et les enjeux plus larges relatifs aux droits des personnes détenues.
Contexte et déroulé des faits
Le transfert entre établissements et le constat initial
Le 23 août 2022, un détenu incarcéré au centre de détention de Châteaudun (Eure‑et‑Loir) est transféré vers le centre pénitentiaire d’Orléans‑Saran (Loiret). Comme le veut la procédure, un inventaire de ses effets personnels est dressé avant le transfert : vêtements, objets d’hygiène, documents, mais aussi une console de jeux (et sa manette).
À l’arrivée dans le nouvel établissement, un second inventaire est réalisé. Or, ce dernier ne recense plus la manette et signale que la console présente un disque dur endommagé. Le détenu informe alors l’administration pénitentiaire de la disparition et de la détérioration de ses biens, mais sa demande de réparation est rejetée.
Le recours devant le tribunal administratif et le jugement
Face au refus administratif, le détenu saisit la justice administrative. Le 9 septembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans lui donne raison. L’État est condamné à verser 200 € au titre de l’indemnisation, avec intérêts.
La décision précise que la responsabilité de l’État est engagée dès lors qu’un « défaut dans l’organisation du transfert » peut être démontré, en prenant en compte les contraintes propres au service public pénitentiaire.
Le tribunal relève notamment que les inventaires effectués avant et après transfert divergent sur le contenu, ce qui permet d’établir un lien de présomption entre la détérioration/perte et le transfert.
Fondement juridique : responsabilité de l’État et biens détenus
Responsabilité de l’administration pénitentiaire
La jurisprudence administrative admet qu’une autorité publique peut être tenue responsable d’un dommage causé à un bien confié à sa garde, dès lors que ce dommage est imputable à un manquement dans l’organisation ou la mise en œuvre des mesures de protection. Dans ce cas précis, le tribunal a estimé que l’État n’avait pas mis en place les moyens suffisants pour garantir l’intégrité des objets durant le transfert.
Il s’agit donc d’une responsabilité de nature administrative, non d’une responsabilité pénale, et le juge administratif contrôle que l’administration ait respecté ses obligations de diligence.
Limites, montant et symbolique de l’indemnisation
L’indemnisation de 200 €, bien que modeste, traduit l’affirmation du droit pour un détenu à un recours effectif pour ses biens personnels. Le détenu réclamait une somme plus élevée (environ 460 € selon certains médias) mais le tribunal n’a pas retenu le montant présenté dans son intégralité, probablement en raison des éléments de preuve soumis ou de l’évaluation du préjudice.
Le jugement souligne que si la somme paraîtra symbolique pour beaucoup, son intérêt est dans le principe : l’administration ne peut refuser toute responsabilité pour des biens personnels en s’abritant derrière des contraintes logistiques ou de sécurité.
Droits et biens personnels en milieu carcéral : règles et enjeux
Les objets autorisés en détention
Dans les établissements pénitentiaires français, certains biens personnels sont autorisés, sous conditions strictes. Parmi eux : les livres, radios, télévisions (dans certains cas), et parfois les consoles de jeux, mais uniquement des modèles sans accès Internet, et avec des jeux validés par l’administration. Ces objets doivent être déclarés dans l’inventaire et remis en l’état en cas de transfert ou de sortie.
Les détenus acquièrent souvent ces biens via la « cantine » (catalogue administratif) ou par des colis familiaux, ce qui les distingue d’objets prêtés ou mis à disposition par l’administration.
Le droit au recours et à la réparation
Le cas de cette console rappelle qu’un détenu dispose d’un droit de recours face à l’administration, même en milieu carcéral. Si l’administration refuse, le recours à la justice administrative peut aboutir à une indemnisation lorsque la responsabilité est reconnue.
Ceci s’inscrit plus largement dans la logique des garanties fondamentales auxquelles les personnes détenues ne doivent pas être privées de fait. En effet, le droit français et le droit européen imposent que les conditions de détention respectent la dignité et les droits fondamentaux, y compris la protection des biens personnels confiés.
Comparaison aux recours d’autres préjudices
Les principes d’indemnisation d’un bien endommagé en milieu carcéral relèvent d’un schéma similaire à d’autres cas où l’administration doit répondre de ses actes. De manière générale, toute personne peut demander réparation quand un dommage est causé par une autorité publique, si les conditions de responsabilité sont réunies (faute, lien de causalité, préjudice).
En ce qui concerne la détention, le ministère de la Justice communique sur le nombre de requêtes d’indemnisation (principalement pour détention provisoire injustifiée) : en 2023, près de 520 demandes ont débouché sur une indemnisation, pour un montant total record de 15 millions d’euros. Cela montre une tendance croissante à la reconnaissance de préjudices liés au fonctionnement carcéral.
Enjeux et perspectives
Un signal juridique et symbolique
Cette décision renforce l’idée que les détenus gardent des droits, même limités, sur leurs biens, et que l’État doit assumer ses obligations, même dans des contextes très contrôlés comme le milieu carcéral. Elle peut encourager d’autres détenus à faire valoir leurs droits en cas de dommages matériels.
Vers une meilleure protection des biens en détention ?
Si la décision est modeste en montant, elle peut inciter l’administration pénitentiaire à renforcer les processus d’inventaire, de transport et de sécurisation des biens personnels lors des transferts. Le respect rigoureux de l’inventaire initial et final, des conditions d’emballage, de manutention et de contrôle pourrait prévenir de tels contentieux à l’avenir.
Questions ouvertes
- Comment l’administration pénitentiaire va-t-elle adapter ses pratiques pour limiter ce type de litiges ?
- Dans quelle mesure ce cas isolé pourra‑t-il faire jurisprudence pour d’autres biens (par exemple des objets plus précieux) ?
- L’accès à un recours effectif pour les détenus est-il suffisamment promu et garanti dans tous les établissements pénitentiaires ?
La condamnation de l’État à indemniser un détenu pour une console de jeux endommagée pendant un transfert peut sembler un fait divers curieux, mais ce jugement touche à des questions fondamentales sur les droits des personnes détenues et les obligations de l’administration pénitentiaire.
Au-delà du montant modeste, 200 €, la décision affirme qu’un détenu peut obtenir réparation d’un préjudice matériel subi dans le cadre de l’exécution de sa peine. Il appartient désormais à l’administration de tirer les leçons de cette décision pour améliorer la protection des biens personnels en détention et aux détenus de savoir qu’un recours est possible.