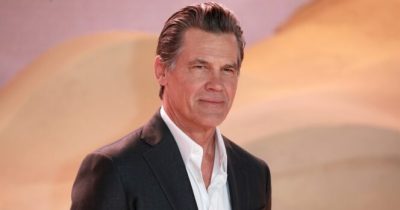Une nuit d’août 2025, à Martigues, Sylvia, 43 ans, est violemment agressée par son compagnon. En détresse, elle appelle les secours à neuf reprises. Les réponses qu’elle obtient sont glaçantes : on lui dit de « prendre un taxi », on la traite de “psychiatrique”, on l’interroge sur la véracité de ses appels.
Finalement, elle succombe à une hémorragie interne. Son compagnon est mis en examen pour violences mortelles, et une enquête est ouverte pour non-assistance à personne en danger. Ce drame interroge l’efficacité des services d’urgence et la responsabilité des secours face aux détresses graves.
Le déroulé du drame
Une dispute, des coups et une fuite
Selon les premiers éléments, une dispute éclate entre Sylvia et son compagnon, identifié comme Samir M.. Dans l’appartement, la violence monte. Sylvia est battue, développe des maux de tête et de violentes douleurs abdominales. Son compagnon quitte les lieux. En état de choc, elle tente de joindre les secours.
Lors de la première intervention des pompiers, elle indique avoir été frappée. Mais elle décline d’être transportée à l’hôpital, invoquant qu’elle souhaite d’abord porter plainte. Cette décision, compréhensible du point de vue de la victime, a été fatale : son état se dégrade.
Neuf appels, aucun secours effectif
Dans la nuit qui suit l’agression, Sylvia multiplie les appels au 18 (pompiers/SDIS) et au SamU.
Aux opérateurs du 18, elle est confrontée à des réponses choquantes : une opératrice lui demande si elle plaisante, un autre lui dit « il va falloir arrêter d’appeler, on n’est pas des taxis » avant de transférer l’appel en qualifiant son état de “psychiatrique”.
Un médecin du Samu, lorsqu’elle parvient à lui parler, lui suggère de “prendre un taxi” ou de demander à quelqu’un de la conduire aux urgences — alors qu’elle se vidait de son sang. Ces échanges, révélés par des écoutes judiciaires, mettent en lumière une double carence : l’absence de reconnaissance de la gravité de la situation et le rejet explicite des appels à l’aide.
Au total, entre 9 appels en quatre heures, aucun secours digne de ce nom n’a été renvoyé sur les lieux. Une voisine, en voyant l’inactivité persistante, finit par découvrir son corps sans vie quelques heures plus tard.
Les enjeux judiciaires
Violences mortelles et mise en examen
Le compagnon est mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L’enquête devra établir le lien entre les coups subis, les blessures internes et la défaillance des secours. Le passé judiciaire de Samir M. sera scruté : selon les sources, il aurait déjà été connu pour des faits de violences ou des délits, bien que rien ne semble indiquer qu’il ait déjà été condamné pour violences conjugales.
Non-assistance à personne en danger
Parallèlement, une information judiciaire est ouverte pour non-assistance à personne en danger contre les services de secours — pompiers, SDIS, Samu — pour n’avoir pas répondu de façon adéquate aux appels. Le procureur d’Aix-en-Provence a confirmé l’existence de ce volet d’enquête. Les auditions porteront sur les protocoles d’appel, la formation des opérateurs, la traçabilité des communications et le suivi des interventions.
Le poids des témoignages familiaux
Le père de Sylvia a dénoncé l’inaction des secours : « On a laissé mourir ma fille », déclare-t-il, exprimant un sentiment d’abandon par les institutions. Selon lui, Sylvia évoquait son état de plus en plus alarmant durant les appels : « Je vais mourir », « Je me fais dessus », mais n’a jamais été secourue.
Contexte : précédents tragiques et enjeux de responsabilité
Affaire Naomi Musenga, un précédent emblématique
Un écho hélas connu résonne dans l’affaire Naomi Musenga (Strasbourg, 2017). Cette femme, en forte douleur abdominale, avait contacté le Samu. L’opératrice avait minimisé ses appels, lui conseillant d’appeler un médecin plutôt que d’envoyer une ambulance. Elle est décédée quelques heures plus tard. La justice a ultérieurement condamné l’opératrice pour non-assistance à personne en danger.
Cette affaire a incrusté dans le débat public la nécessité de repenser le fonctionnement des numéros d’urgence, la qualification des appels et la responsabilité du système face à des situations de détresse.
Enjeux institutionnels et formation des secours
Le drame de Sylvia pose une question grave : les opérateurs, pompiers et médecins sont-ils suffisamment formés pour détecter les signaux de gravité, en particulier dans des contextes de violences conjugales ? Le système associe souvent des critères stricts avant déclenchement d’une intervention. Le défi est d’assurer une réactivité adaptée tout en évitant les interventions abusives.
Les services d’urgence devront rendre des comptes sur leur gestion des appels, les délais, l’orientation des ressources et la traçabilité des décisions qui ont conduit à ne pas se déplacer.
Le sort de Sylvia, meurtrie puis abandonnée au fil de neuf appels, met en lumière une faille tragique entre la victime et les services de secours. La mise en examen du compagnon pour violences mortelles, et l’ouverture du volet pour non-assistance à personne en danger, ouvriront un combat judiciaire long et sensible.
Au-delà du cas individuel, ce drame exhorte les institutions à repenser les protocoles d’urgence, la formation des opérateurs, et la responsabilité de l’État envers ceux qui appellent au secours.
LIRE AUSSI : Deux ans après le drame : la mère de Lola brise le silence
LIRE AUSSI : Noyade tragique d’un adolescent dans la Marne : un appel à la vigilance